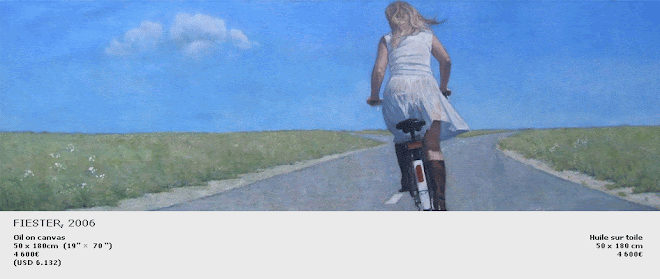"Si on change constamment de place pour forer un puits, on ne trouvera jamais d’eau."
Ramakrishna
Ramakrishna
( La scène a lieu chez les Todas de Mukurti peak, dans les montagnes bleues au sud de l'Inde. Cette communauté perpétue une tradition celtique.)
Le maître dit :
— Ce qui sauve, c’est la religion pour les masses, gouvernées par les besoins de base et s’éveillant lentement à la vie de l'âme. C’est la philosophie pour ceux qui affectionnent les idéaux et qui guident les peuples. Et, pour ceux qui voient dans le monde des symboles, les mythes et les réalités supra-physiques, c’est la voie étroite de la sagesse qui libère. Cela ne veut pas dire que les uns et les autres ne soient pas mêlés dans leurs affects. Au contraire, tous les niveaux de perception et de lucidité s’interpénètrent. Tous les hommes se rassemblent dans le cœur de Dieu. Et quelles que soient les images de la divinité qu’ils se taillent, dans les formes du langage ou dans la chair, tous se retrouvent au seuil de la mort, comme de simples êtres abandonnés à l’inconnu. La sagesse consiste à savoir où l’on se trouve, dans notre propre évolution spirituelle et à agir en conséquence ; elle est le lien entre les différents mondes de la pensée humaine. La foi quant à elle est un acte pur, l’espoir en action.
Un disciple questionne :
— Mais quel est le rapport entre la religion et la philosophie ?
Le maître répond :
— La religion fabrique des dogmes sur lesquels s’étayent des modes de vie, alors que la philosophie élabore des systèmes de compréhension ou du moins des lignes d’approche et d’appréhension de la vérité. L’âme pense le monde et le corps, lui, délimite le champ d’action de la conscience. Tout comme l’église organise sa communauté autour de ses rites propres, vous êtes astreint à agir dans le cercle dynamique produit par votre personnalité. C’est à travers la liturgie que les prêtres entretiennent la vitalité des mythes et des symboles, comme champs de potentialités, pour « les petits », ceux qui ne voient pas encore, pour qui le monde de la signification demeure voilé. Les fidèles, tout au long du sacrement, sont traversés par des signes qu’ils assimilent peu à peu sans interprétations. Les philosophes et les prophètes sont pénétrés constamment par des faisceaux de lumière, des segments de significations qu’ils reproduisent grâce à leur génie créateur.
Un soir chez Lange, Charles HORACE.