Vermeer, Vue de Delft
« Toi qui ne brûle pas du désir
de savoir et de l’amour de la liberté, évite cette pierre tombale ». Hugo de Groot.
Hormis
l’ambiance religieuse et quasi surnaturelle du lieu, qui concourt à remplir d’un
sentiment de grandeur toute âme en quête d’unité, mon cœur dû tressaillir
devant l’épitaphe inscrite sur une dalle de pierre dans le déambulatoire de cette
Nieuwe Kerk, sous le mausolée
d’un homme de justice. Elle dit ceci : « Toi qui ne brûle pas du désir
de savoir et de l’amour de la liberté, évite cette pierre tombale ».
C’est signé Hugo de Groot.
Je me sentais comme foudroyé et honteux. Pensant aux divers ethnocides et
génocides de notre histoire, aux droits de l’homme bafoués encore à notre
époque, à la destruction drastique d’un environnement fragile, à l’occultation cynique
des sagesses anciennes, je me demandais combien d’hommes s’étaient levés dans
le monde, depuis près de quatre siècles, qui purent fréquenter cet apostolat
sans culpabilité.
Un
être seul, dit-on, c’est une interrogation dans un texte. Un point qui séduit,
mais qui, en même temps, génère un certain malaise. Tandis que le train
rencontre la lumière fractale et que s’alternent les sirènes de la locomotive
et les annonces de l’hôtesse, silencieusement je m’isole. Je me retire du monde
pour errer dans le maquis des ombres. Bizarrement, c’est là que l’homme semble
puiser sa force psychique. Dans ces formes fantasques qu’il tente de réunir
maladroitement. Les mirages sont des écueils auxquels on se raccroche par temps
d’orage. Le contrôleur s’approche :
-
Goedendag ! dit-elle, avec un sourire de blonde courtoise dans sa tenue
bleu nuit largement éclaircie par son teint nordique.
-
Dag !
Retiré
du néant, je présente mon ticket, tout heureux et profitant de l’interlude pour
croiser deux ou trois regards distraits au hasard des passagers assis dans le
wagon. Depuis le départ, en fait, j’étais absorbé dans mes monochromes. Les
visions d’un passé encore chaud tournoyaient et je respirais, je crois, n’ayant
plus conscience des autres voyageurs. Mais ici tout est calme, ou presque...
-
Dank u ! « bon voyage », ajoute-t-elle en français.
Un
peu plus loin, deux enfants jouent avec un panier posé sur la table. Il est
ouvert. Un troisième, amusé, regarde. Puis un animal, un petit chat de
gouttière noir et blanc, il sort du panier et fait des bonds, des petits sauts
très précis. Il se jette vivement sur les objets que les mômes lancent au
milieu de la table, il les fait gicler en l’air et aussitôt regagne son abri.
Les gosses rient en boucle, en toute complicité. Ils sont satisfaits de cette
comédie animalesque. Et ils recommencent… le chat, les objets, le panier, les
rires. Déjà, mes membres sont revivifiés. Je me lève pour aller dans le couloir
fumer une cigarette. Juste histoire de faire autre chose. Le jeu des gamins m’a
un peu rafraîchi.
Ces
enfants, malicieux et frivoles, qui jouent en face du monde, et parfois des
pires dangers, je les vois génies, anges, lubies. Agrandis par tout l’amour qu’on
leur a donné, la générosité qui leur a fourni l’espace d’une vie sécure et
l’intérêt qu’on leur accorde à chaque instant, ils savent rendre la joie
visible au cœur des tourments de nos vies pétrifiées d’adultes. Les visages des
enfants, souvent radieux, opèrent dans mon âme, insensiblement et comme par
magie, une transfiguration qui souligne mes conceptions distordantes. « Le
royaume de Dieu appartient aux enfants », dit Jésus. L’impermanence
des choses est transcendée dans l’oubli de soi. L’oubli de soi, la sérénité,
n’est possible probablement que par l’abandon des expériences passées. Parce
que l’apport de ces expériences recouvre, falsifie et dénature
l’innocence ; parce que la mémoire tue l’instant naïf.
La
lumière coule à flots impétueux. Les contraires se croisent, et dans le prisme
des formes ils éclatent en rayons de couleurs transparentes. Puis, ils
s’effacent, ils renaissent, ils s’effacent et je me dégage de leur radiance.
Ils renaîtront. Mais, lentement, je retourne à mes souvenirs. Je remonte à ce
matin de juillet, pendant les vacances scolaires, pendant que les champs sont
tout blonds, où nous avions regardé des pierres. Nous les jetions dans un
étang, et à mesure qu’elles coulaient nous recommencions le cœur en liesse.
Dans les rares moments de calme, j’étais absorbé dans un spectre de lumière, un
miroir brisé qui laissait transparaître des traces anguleuses. Celles des
arbres autour, descendues du ciel pour se plaquer dans les eaux mortes, celles
des herbes fluides, fascinantes comme des fées, comme des drogues douces.
Avec
les visages fleuris d’enfants libres, nous étions plein de gaieté et de
désinvolture ; Claude, c’était un papillon, un sourire inscrit dans l’air
et qui se respirait comme un parfum d’oranges. Il semblait être nu comme un
têtard, une vierge dans l’absurdité du moment. Brahim, lui, donnait ses grands
yeux et toute son ardeur aux plaisirs du compagnonnage. La vie est une
succession d'événements, dont l’origine nous est incertaine. Dans cette eau,
calme et stable, aux puissants reflets d’or et d’argent, il y avait de la vie.
Au commencement surtout, elle était dans la vie et la vie même. Nous sommes
arrivés et tout a changé.
Les
décisions d’hier sont les moteurs ou les freins d’aujourd’hui, et qui que nous
soyons devenu, elles nous apprennent encore à décider pour demain. Quelque fois
on se dit que cela n’a pas d’importance et que tout ira mieux. C’est une des
raisons de la vie active et intense que nous choisissons. Les bulles qui
remontaient du fond nous faisaient rire, et l’étrangeté de l’acte ne nous
saisissait aucunement, nous passions outre. L’absurde se baladait discrètement
parmi les stridulations d’insectes, abondants, et les croassements confus des
corneilles excitées. Nous venions à cet endroit pour connaître la mort, la fin
d’une vie de chat.
Ce
chaton, au poil blanc immaculé, avait eu cette fin tragique — traqué par trois
jeunes loups inspirés de mauvais plans —, trahit par ses pépites azur — on
disait de cette espèce qu’elle était atteinte de cécité —, nous l’avions noyé
au fond du « marais des noces » ; c’était le nom qu’on donnait à
cet endroit, proche de la cité, où les couples venaient se baptiser dans la
sensualité des corps, épiés par les regards illimités de la nature. « Il
coule », assura Claude d’un ton naïf. Le commentaire fut bref. Alors que
nous observions la vie se transformer en bain d’eau glacé, nous prenions
conscience de notre médiocrité. Nos notes grotesques obtenues à l’école de la
complaisance, les actes ridicules d’une jeunesse traînante et sans esprit
rendaient notre présence d’un intérêt superfétatoire.
Nous
étions là sans y être vraiment, nus, fixés dans le décor. L’acte nous avait
submergés et la parole avait été engloutie au fond de la mare. A quelques
mètres seulement. Quelques minutes suffirent à mes deux frères pour coller à
leurs vêtements. Nous étions devenus membres d’une confrérie secrète.
Connaissants d’un savoir minable, mais somme toute initiatique, la peur d’être
pris pour des assassins nous fit apprendre à garder le silence. Nous prîmes le
chemin à rebours avec des visages de tombes et, en nous jurant de ne rien dire
à personne, avec un gros noeud dans le ventre. Le chat est mort, mais
qu’importe, toute transition fait changer de peau. En même temps qu’on délaissait
les « choses du passé », le présent, lui, nous réjouissait déjà d’une
prise de conscience au caractère profond : la vie était devenue un sacre.
La
symbolique des événements frappe notre conscience, dès lors qu’elle est
éveillée et, surtout en rapport avec l’ouverture de notre esprit, elle inspire.
La mort, la nature féline enfouie dans les profondeurs de l’inconscient — sorte
de réserve mystérieuse de forces et de pulsions —, la sexualité créatrice et
destructrice de l’homme, nous commencions à découvrir cela à cause du silence
qui régnait autour de la mare. Le temps était venu pour nous de comprendre ce
que signifiait la mort, comme disparition et comme silence indéterminable.
Parce que toutes les images de la mort se ramifiaient parmi tous mes souvenirs,
je réalisai subitement, avec cette sorte de lucidité, cette faculté
d’interprétation de ma propre vie, que finalement je n’étais qu’un passager.
Comme
dans ce train, alors le yin et le yang se dessinaient dans ma mémoire
rétinienne, dans cette mémoire d’adolescent qui balayait toute incertitude et
qui transformait le souffle en absence. L’orgueil, ce n’est pas une faute qu’on
a peur de corriger, ou une faiblesse qu’on veut entretenir par satisfaction ou
par plaisir, mais c’est une maladie de l’âme adolescente qui s’attache à sa
propre importance sans regard pour les autres. Comme la nature, cette mère si
sage qui nous avait regardés, nous avons dû de temps en temps quitter nos sales
vêtements usés en pleurant, même ceux qui nous faisaient paraître merveilleux,
pour recueillir le silence de la nudité et contempler notre petitesse en riant
aussi.




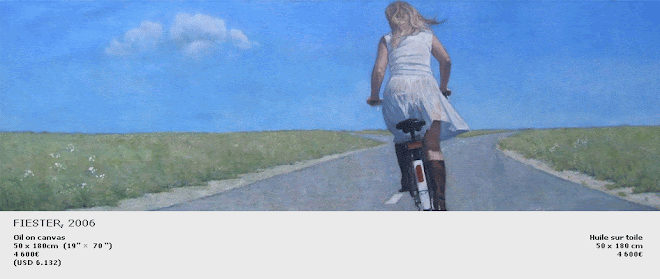
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire