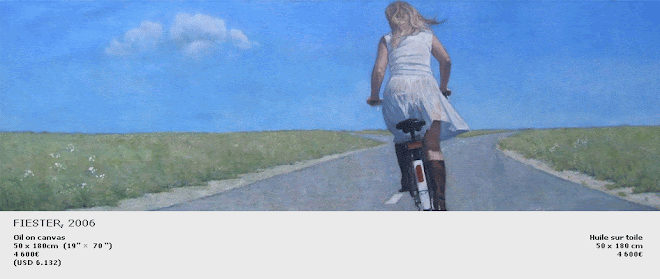samedi 17 avril 2010
lundi 12 avril 2010
La reinette du lotus chante à la pluie
« Toute la grâce du jour dans la fleur du matin »
André Suarès
Lorsque nous arrivâmes à Mumbaï, nous fûmes écrasés par une chaleur d’un poids étonnant. A la fatigue due au transport aérien venait maintenant s’ajouter une oppression au niveau de la cage thoracique. La respiration devenait de plus en plus difficile et jusqu'à être, d’une certaine façon, plus pénible encore que la charge de nos bagages. Dès que nous eûmes rempli les dernières formalités douanières, nous nous précipitâmes vers une sortie pour prendre « un peu d’air ». Là, devant le cortège des voyageurs qui choisissaient leurs taxis, Picart eu un accès de rire qui devint contagieux. Je ne pus m’empêcher de rire aux éclats. Nous riions sans raison évidente. C’était tout simplement un déversement de joie en pleine fatigue. Je crois qu’il n’y avait pas d’autre explication à cela.
— Nous allons prendre un taxi pour nous rendre au centre ville, dis-je. Je sentis soudain une présence à côté de nous. Je me tournais légèrement vers ma droite. Je vis une jeune femme s’approcher prudemment.
-- Vous allez prendre un taxi, n’est-ce pas ? lança-t-elle timidement. Je lui répondis par l’affirmative. Puis-je me joindre à vous ? Elle parut dès l’abord un peu gênée, voire même effrayée et surprise par l’assistance plutôt primaire du personnel de l’aéroport et de tous ceux qui harcelaient les voyageurs, les haranguant de leurs divers services. Je fus saisi d’un sentiment confraternel franco-français et, sans consulter mon ami, je lui proposais d’aller ensemble jusqu'à l’hôtel que nous avions choisi dans le « guide du touriste parfait ».
— Moi c’est Picart. Et vous ?
— Je m’appelle Teren. Je suis parisienne. C’est la première fois que...
— Moi aussi ! c’est assez surprenant comme ambiance. On s’est éloigné de nos carillons, mais je crois que cela ne va pas nous faire de mal.
Picart laissait l’impression d’être tout à fait dans son aise. La jeune femme lui avait fait oublier ses récentes interceptions incongrues et lui fit prendre un tour plus assuré. Pendant qu’ils parlaient tous deux je captais une voiture. Nous montâmes dedans avec nos bagages, puis nous prîmes tous ensemble notre souffle dans un long moment de silence régénérateur.
— Voilà l’hôtel Krishnananda... Toisa-t-il. Picart fût le premier, comme toujours, à couper le silence en deux. Il avait même cette particularité, cette complaisance dans l'ébranlement du monde qu'on remarque nettement dans les médias quand on s'en est passé pendant quelques temps.
En entrant dans la chambre, Teren s’arrêta brusquement. Elle vit un petit insecte rampant de couleur brun-rougeâtre. Il était juste sous la lampe, immobile, en train de digérer je ne sais quelle nourriture, ou bien il se cachait dans cette posture croyant, peut-être, qu’en cela il serait rendu transparent, invisible à l’œil de l’homme. C’était pas très encombrant mais assez dégoûtant pour ne pas résister à son évincement. Picart s’avança.
— Tu ne vas pas l’écraser enfin, dit-il. Ce n’est qu’une petite bête, qui se nourrit de farines et autres sucreries qui traînent dans les placards et sur le sol.
Il eu à peine le temps de finir sa remarque. Teren frappa d’un coup de journal cette « petite bête » malvenue. Sous le choc de la tapette, on entendit un craquement et, dans mon estomac, un léger mouvement révulsif accompagna mon interrogation. Moumouk-chou (désir-d’être-libéré) était là, discret. Il assista à la scène sans dire un mot, tout en maintenant un léger sourire dans son visage attendri. Puis, il prit un bout de papier, enveloppa l’insecte écrasé et le jeta dehors. Après cet interlude d’une naïveté certaine, il nous montra la salle d’eau, qui comportait une douche, un lavabo surmonté d’un miroir, et l’endroit de soulagement.
— Si cette chambre vous convient, reprit-il, ce sera deux-cents roupies par jour. Vous pouvez régler tout à l’heure le montant de la première nuit, à l’accueil où vous présenterez un passeport et remplirez une fiche d’hôtel, et le restant lors de votre départ. Je suis à votre disposition. Pour m’appeler, vous n’aurez qu’à sonner en appuyant là-dessus. Il mis le doigt sur l’interrupteur qui se trouvait tout près de la porte d’entrée, et glissa fermement la clé de chambre dans la serrure de la porte avant de s’en aller tranquillement.
André Suarès
Lorsque nous arrivâmes à Mumbaï, nous fûmes écrasés par une chaleur d’un poids étonnant. A la fatigue due au transport aérien venait maintenant s’ajouter une oppression au niveau de la cage thoracique. La respiration devenait de plus en plus difficile et jusqu'à être, d’une certaine façon, plus pénible encore que la charge de nos bagages. Dès que nous eûmes rempli les dernières formalités douanières, nous nous précipitâmes vers une sortie pour prendre « un peu d’air ». Là, devant le cortège des voyageurs qui choisissaient leurs taxis, Picart eu un accès de rire qui devint contagieux. Je ne pus m’empêcher de rire aux éclats. Nous riions sans raison évidente. C’était tout simplement un déversement de joie en pleine fatigue. Je crois qu’il n’y avait pas d’autre explication à cela.
— Nous allons prendre un taxi pour nous rendre au centre ville, dis-je. Je sentis soudain une présence à côté de nous. Je me tournais légèrement vers ma droite. Je vis une jeune femme s’approcher prudemment.
-- Vous allez prendre un taxi, n’est-ce pas ? lança-t-elle timidement. Je lui répondis par l’affirmative. Puis-je me joindre à vous ? Elle parut dès l’abord un peu gênée, voire même effrayée et surprise par l’assistance plutôt primaire du personnel de l’aéroport et de tous ceux qui harcelaient les voyageurs, les haranguant de leurs divers services. Je fus saisi d’un sentiment confraternel franco-français et, sans consulter mon ami, je lui proposais d’aller ensemble jusqu'à l’hôtel que nous avions choisi dans le « guide du touriste parfait ».
— Moi c’est Picart. Et vous ?
— Je m’appelle Teren. Je suis parisienne. C’est la première fois que...
— Moi aussi ! c’est assez surprenant comme ambiance. On s’est éloigné de nos carillons, mais je crois que cela ne va pas nous faire de mal.
Picart laissait l’impression d’être tout à fait dans son aise. La jeune femme lui avait fait oublier ses récentes interceptions incongrues et lui fit prendre un tour plus assuré. Pendant qu’ils parlaient tous deux je captais une voiture. Nous montâmes dedans avec nos bagages, puis nous prîmes tous ensemble notre souffle dans un long moment de silence régénérateur.
— Voilà l’hôtel Krishnananda... Toisa-t-il. Picart fût le premier, comme toujours, à couper le silence en deux. Il avait même cette particularité, cette complaisance dans l'ébranlement du monde qu'on remarque nettement dans les médias quand on s'en est passé pendant quelques temps.
En entrant dans la chambre, Teren s’arrêta brusquement. Elle vit un petit insecte rampant de couleur brun-rougeâtre. Il était juste sous la lampe, immobile, en train de digérer je ne sais quelle nourriture, ou bien il se cachait dans cette posture croyant, peut-être, qu’en cela il serait rendu transparent, invisible à l’œil de l’homme. C’était pas très encombrant mais assez dégoûtant pour ne pas résister à son évincement. Picart s’avança.
— Tu ne vas pas l’écraser enfin, dit-il. Ce n’est qu’une petite bête, qui se nourrit de farines et autres sucreries qui traînent dans les placards et sur le sol.
Il eu à peine le temps de finir sa remarque. Teren frappa d’un coup de journal cette « petite bête » malvenue. Sous le choc de la tapette, on entendit un craquement et, dans mon estomac, un léger mouvement révulsif accompagna mon interrogation. Moumouk-chou (désir-d’être-libéré) était là, discret. Il assista à la scène sans dire un mot, tout en maintenant un léger sourire dans son visage attendri. Puis, il prit un bout de papier, enveloppa l’insecte écrasé et le jeta dehors. Après cet interlude d’une naïveté certaine, il nous montra la salle d’eau, qui comportait une douche, un lavabo surmonté d’un miroir, et l’endroit de soulagement.
— Si cette chambre vous convient, reprit-il, ce sera deux-cents roupies par jour. Vous pouvez régler tout à l’heure le montant de la première nuit, à l’accueil où vous présenterez un passeport et remplirez une fiche d’hôtel, et le restant lors de votre départ. Je suis à votre disposition. Pour m’appeler, vous n’aurez qu’à sonner en appuyant là-dessus. Il mis le doigt sur l’interrupteur qui se trouvait tout près de la porte d’entrée, et glissa fermement la clé de chambre dans la serrure de la porte avant de s’en aller tranquillement.
lundi 8 février 2010
Le bain des dauphins
Comme chaque matin au lever, je regardais attentivement Ramaya qui renouait sa tresse. J’aimais ses longs cheveux noirs. Ils sentaient le jasmin et l’huile de coco, ou le santal, selon le jour, et brillaient sous la lampe de notre petite chambre. La nuit, on entendait les vagues, et les souffles...
Au bord de l’eau, je pensais à nous, à la nuit avec ses bruits, ses mystères et ses étoffes de coton et de soie moites. Pendant que les autres faisaient des prières ou des austérités, je laissais mon coeur s’enflammer librement. Un cortège de dauphins nageait vers le nord, tous les jours à la même heure on pouvait les apercevoir au-dessus de la ligne d’eau qui marque la fin du ciel. Quelques sauts arrondis pour donner un rythme à leur voyage quotidien. Les dauphins nagent sur le fil qui unit le ciel et la terre, devant l’horizon blanchi découpé par des nuées d’un blanc cendré.
Au retour, j’écoutais les crépitements des feuilles d’eucalyptus sous mes pieds, qui tombaient doucement chaque jour sur le sable et séchaient sous un soleil de fer. Et, à peine arrivé, je racontais tout. Tout ce que m’avaient murmuré les vents de la plage, près de la vieille Pagode en granit menacée par les vagues de l’océan. Ramaya souriait généreusement dans sa chandelle de soie bleu ciel. Pendant ce temps, elle préparait le thé que nous allions prendre, accommodé avec de petits gâteaux secs et des chants mélodieux. Installé dans un modeste confort, j’écrivais tous les jours en l’adorant; elle était mon «Ishta devata», la forme de mon adoration. Elle ne voulait rien dire, mais ses yeux me disaient tout.
Quand le soleil était déjà haut, et qu’il faisait chaud, Gopi s’agitait. On ne tenait pas facilement sans rien faire. Pour moi, c’était : douche, lecture ou balade... Lorsque je le questionnais, il me répondait assez franchement des choses simples, très simples. Des choses toutes bêtes, comme mes questions d’ailleurs. Personne ne pouvait imaginer cela. Je lui demandais ce qu’il pensait de la vie, et il me répondait: «I don’t know!». Il voulait faire comprendre quelque chose avec son petit anglais et son accent madrasi. J’essayais de ne pas trop réfléchir à cela. Puis il partait tranquillement, pour des heures, en ville. Lorsque nous étions seuls, Ramaya et moi, nous passions de longs moments ensemble dans la contemplation, nous traversions progressivement de longs stades d'un silence qui nous apportait le calme et le bien-être.
Rien que pour nous, rien que pour s’aimer d’une autre manière, nous invoquions les divinités hindous, celles de la grâce et de la beauté, Sri Lakshmi et Nârâyana avec sa conque, son disque d’or, sa masse et la fleur de lotus. Les brahmanes du temple de l’éléphant m’avaient éclairé sur le sens des gestes et des mouvements du corps. Ils me révélèrent quelques unes de leurs connaissances à propos du yoga, la science royale de l’union. Les jambes croisées et le buste droit, la nuque détendue, je pratiquais sans excès un ou deux exercices par jour. Le plus important, avais-je saisi, c’était de contrôler mon souffle.
Le souffle vital, comme le vent pousse les vagues, reconduit notre âme dans le ciel, disaient-ils. La posture est également très importante. L’attitude du corps dans les occupations de l’esprit est fonction de nos qualités acquises au cours de notre périple depuis la première naissance. La vie d'ici-bas, c’est la vie tout court. L’hindou se réincarne encore et encore jusqu’à la libération finale, jusqu’à l'extinction du désir d'être un être séparé du grand tout, cause d'illusion, pour atteindre le Samadhi, une éternelle vérité dans la grande union cosmique.
Charles Horace, Un soir chez Lange.
Au bord de l’eau, je pensais à nous, à la nuit avec ses bruits, ses mystères et ses étoffes de coton et de soie moites. Pendant que les autres faisaient des prières ou des austérités, je laissais mon coeur s’enflammer librement. Un cortège de dauphins nageait vers le nord, tous les jours à la même heure on pouvait les apercevoir au-dessus de la ligne d’eau qui marque la fin du ciel. Quelques sauts arrondis pour donner un rythme à leur voyage quotidien. Les dauphins nagent sur le fil qui unit le ciel et la terre, devant l’horizon blanchi découpé par des nuées d’un blanc cendré.
Au retour, j’écoutais les crépitements des feuilles d’eucalyptus sous mes pieds, qui tombaient doucement chaque jour sur le sable et séchaient sous un soleil de fer. Et, à peine arrivé, je racontais tout. Tout ce que m’avaient murmuré les vents de la plage, près de la vieille Pagode en granit menacée par les vagues de l’océan. Ramaya souriait généreusement dans sa chandelle de soie bleu ciel. Pendant ce temps, elle préparait le thé que nous allions prendre, accommodé avec de petits gâteaux secs et des chants mélodieux. Installé dans un modeste confort, j’écrivais tous les jours en l’adorant; elle était mon «Ishta devata», la forme de mon adoration. Elle ne voulait rien dire, mais ses yeux me disaient tout.
Quand le soleil était déjà haut, et qu’il faisait chaud, Gopi s’agitait. On ne tenait pas facilement sans rien faire. Pour moi, c’était : douche, lecture ou balade... Lorsque je le questionnais, il me répondait assez franchement des choses simples, très simples. Des choses toutes bêtes, comme mes questions d’ailleurs. Personne ne pouvait imaginer cela. Je lui demandais ce qu’il pensait de la vie, et il me répondait: «I don’t know!». Il voulait faire comprendre quelque chose avec son petit anglais et son accent madrasi. J’essayais de ne pas trop réfléchir à cela. Puis il partait tranquillement, pour des heures, en ville. Lorsque nous étions seuls, Ramaya et moi, nous passions de longs moments ensemble dans la contemplation, nous traversions progressivement de longs stades d'un silence qui nous apportait le calme et le bien-être.
Rien que pour nous, rien que pour s’aimer d’une autre manière, nous invoquions les divinités hindous, celles de la grâce et de la beauté, Sri Lakshmi et Nârâyana avec sa conque, son disque d’or, sa masse et la fleur de lotus. Les brahmanes du temple de l’éléphant m’avaient éclairé sur le sens des gestes et des mouvements du corps. Ils me révélèrent quelques unes de leurs connaissances à propos du yoga, la science royale de l’union. Les jambes croisées et le buste droit, la nuque détendue, je pratiquais sans excès un ou deux exercices par jour. Le plus important, avais-je saisi, c’était de contrôler mon souffle.
Le souffle vital, comme le vent pousse les vagues, reconduit notre âme dans le ciel, disaient-ils. La posture est également très importante. L’attitude du corps dans les occupations de l’esprit est fonction de nos qualités acquises au cours de notre périple depuis la première naissance. La vie d'ici-bas, c’est la vie tout court. L’hindou se réincarne encore et encore jusqu’à la libération finale, jusqu’à l'extinction du désir d'être un être séparé du grand tout, cause d'illusion, pour atteindre le Samadhi, une éternelle vérité dans la grande union cosmique.
Charles Horace, Un soir chez Lange.
Inscription à :
Articles (Atom)