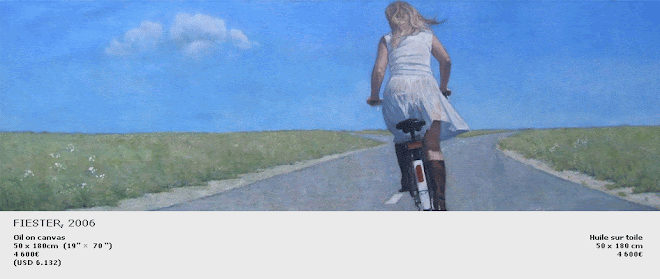Comme chaque matin au lever, je regardais attentivement Ramaya qui renouait sa tresse. J’aimais ses longs cheveux noirs. Ils sentaient le jasmin et l’huile de coco, ou le santal, selon le jour, et brillaient sous la lampe de notre petite chambre. La nuit, on entendait les vagues, et les souffles...
Au bord de l’eau, je pensais à nous, à la nuit avec ses bruits, ses mystères et ses étoffes de coton et de soie moites. Pendant que les autres faisaient des prières ou des austérités, je laissais mon coeur s’enflammer librement. Un cortège de dauphins nageait vers le nord, tous les jours à la même heure on pouvait les apercevoir au-dessus de la ligne d’eau qui marque la fin du ciel. Quelques sauts arrondis pour donner un rythme à leur voyage quotidien. Les dauphins nagent sur le fil qui unit le ciel et la terre, devant l’horizon blanchi découpé par des nuées d’un blanc cendré.
Au retour, j’écoutais les crépitements des feuilles d’eucalyptus sous mes pieds, qui tombaient doucement chaque jour sur le sable et séchaient sous un soleil de fer. Et, à peine arrivé, je racontais tout. Tout ce que m’avaient murmuré les vents sur la plage, près de la vieille Pagode en pierres qui était menacée par les vagues de l’océan. Ramaya souriait généreusement dans sa chandelle de soie bleu ciel. Pendant ce temps, elle préparait le thé que nous allions prendre, accommodé avec de petits gâteaux secs et des chants mélodieux. Installé dans un modeste confort, j’écrivais tous les jours en l’adorant; elle était mon «Ishta devata», la forme de mon adoration. Elle ne voulait rien dire, mais ses yeux disaient tout.
Quand le soleil était déjà haut, et qu’il faisait chaud, Gopi s’agitait. On ne tenait pas facilement sans rien faire. Pour moi, c’était : douche, lecture ou balade... Lorsque je le questionnais, il me répondait assez franchement des choses simples, très simples. Des choses toutes bêtes, comme mes questions d’ailleurs. Personne ne pouvait imaginer cela. Je lui demandais ce qu’il pensait de la vie, et il me répondait: «I don’t know!». Il voulait faire comprendre quelque chose avec son petit anglais et son accent madrasi. J’essayais de ne pas trop réfléchir à cela. Puis il partait tranquillement, pour des heures, en ville. Lorsque nous étions seuls, Ramaya et moi, nous passions de longs moments ensemble dans la contemplation, nous traversions progressivement de longs stades d'un silence qui nous apportait le calme et le bien-être.
Rien que pour nous, rien que pour s’aimer d’une autre manière, nous invoquions les divinités hindous, celles de la grâce et de la beauté, Sri Lakshmi et Nârâyana avec sa conque, son disque d’or, sa masse et la fleur de lotus. Les brahmanes du temple de l’éléphant m’avaient éclairé sur le sens des gestes et des mouvements du corps. Ils me révélèrent quelques unes de leurs connaissances à propos du yoga, la science royale de l’union. Les jambes croisées et le buste droit, la nuque détendue, je pratiquais sans excès un ou deux exercices par jour. Le plus important, avais-je saisi, c’était de contrôler mon souffle.
Le souffle vital, comme le vent pousse les vagues, reconduit notre âme dans le ciel, disaient-ils. La posture est également très importante. L’attitude du corps dans les occupations de l’esprit est fonction de nos qualités acquises au cours de notre périple depuis la première naissance. La vie d'ici-bas, c’est la vie tout court. L’hindou se réincarne encore et encore jusqu’à la libération finale, jusqu’à l'extinction du désir d'être un être séparé du grand tout, cause d'illusion, pour atteindre le Samadhi, une éternelle vérité dans la grande union cosmique.
Charles Horace, Un soir chez Lange.
samedi 6 mai 2017
lundi 1 février 2016
Alchimie
"Il n'y a pas de pont qui conduise des sciences vers la pensée, il n'y a que le saut. Là où il nous porte, ce n'est pas seulement l'autre bord que nous trouvons, mais une région entièrement nouvelle."Martin Heidegger
jeudi 25 septembre 2014
lundi 25 août 2014
dimanche 7 avril 2013
Varanasi and Sarnath - India
« Le saint qui aspire à être dans un certain état de sainteté est aussi agressif que, dans sa basse-cour, la poule qui picore. »
Krishnamurti
vendredi 5 avril 2013
Paméla et le Bouddha de Sarnath
Je
vous est enseigné de ne pas croire uniquement par ouïe-dire, mais lorsque par
votre propre jugement vous croyez, alors agissez en conséquence et sans
réserve.
Bouddha
Sur un rayonnage renfoncé dans un mur de la chambre, il y
avait quelques livres. Rapidement je vis qu’il s'agissait d'éditions anglaises;
tous sauf un. Un roman de Yukio Mishima : le pavillon d’or. Je le
sortis du groupe et je l’ouvris pour y glaner quelques phrases, cherchant
celles qui recelaient le nectar de l’auteur, et j’en trouvais quelques une
d’une extrême beauté. La finesse des propos fit se lever en moi une exaltante
envie de vivre le romancier, et je commençais à tourner les pages, l’une après
l’autre, sans me rendre compte que je quittais l’espace-temps linéaire. Malgré
une mélancolie marquée en profondeur, l’histoire m’avait absorbé. Le livre
fondait dans mes mains et les mots s’enroulaient comme des fils de lumière tout
autour de mon être. A l’instant de terminer un chapitre, derrière la dernière
page je découvris une lettre manuscrite. Cette lettre n’était jamais allée vers
le destinataire prévu. Mais je la dépliais pour la lire. C’était une courte
missive, écrite en français avec des cannes longues et des boucles aux arrondis
renforcés.
« Katmandou, le 10 Janvier 1995.
Salut Rachel,
Je n’ai pas reçu de lettre (ni de coup de fil) depuis
longtemps ; j’espère que tout va bien. Ici, ça baigne ; je suis chaque
jour appliqué à l’exercice de l’écriture et à l’étude des textes de littérature
et de philosophie qui me passionnent, surtout la pensée indienne. C’est pas
toujours drôle, mais ça me plaît. Je pense pouvoir être régulier durant ce
voyage. Les amis me manquent, et la famille aussi, mais j’ai tellement besoin
d’un autre climat... J’ai envisagé de rentrer le 1er Mai. J’espère
qu’il fera bon chez nous. Ici, je loge dans un petit hôtel, situé dans la
vieille ville. La propriétaire est une aimable femme d’avocat. Je serais donc à
Kathmandou pour quelques semaines encore. Je suis avec une amie, qui a fait un
break dans ses études de sociologie. Et ici elle se penche sur le bouddhisme et
la pratique de la méditation. Elle fait des respirations et du silence ; c’est
très agréable! On s’est rencontré en Inde, et on est venu ensemble ici au
Népal. On a fait la route en bus. C’était très marrant.
J’ai eu des nouvelles de Jean-Sanchez. Son père est
décédé récemment au Congo, en plein cœur de la guerre civile. Il était
« Roi » d’une province africaine ; nous avions connu un roi
quand nous étions là-bas, tu te souviens d’Albert ? Lui qui tenait à
garder cela aussi discrètement que possible... Je garderai toujours en mémoire cette
distinction et cette droiture d’esprit. Il était encore camouflé dans ce rôle
de « boy » chez cette famille de colons, que je trouvais tout de même assez
niais. Mes amitiés ont toujours été élaborées lentement, très lentement -- je
ne m’associe qu’avec une certaine retenue --, mais une fois établies elles
demeurent aussi fermes que des liens fraternels. Heureusement, on est branché
sur le même câble ! Aujourd’hui, je tisse des liens avec d’autres
continents, mais j’ai toujours des amis en Afrique avec qui je corresponds de
temps en temps.
Vraiment, je suis désolé de ne pas être plus présent pour
te voir grandir. Je suis confus. Et cette situation après notre séparation avec
ta mère n’arrange rien. Mais j’ai pris des habitudes, et toi aussi sûrement. Je
crois que la vie ne s’arrête pas là et que l’on doit comme elle aller devant
cela. Des jours meilleurs pour passer du temps ensemble viendront. On dit qu’il
ne faut avoir aucun regret. C’est bien ces « on dit », parfois ça
donne raison. En vérité c’est difficile. C’est sûr, tu diras que j’étais absent
et tu m’en voudras beaucoup. Je serais impuissant face à ta colère et mon
silence couronnera le tout. Tu partiras avec « ton compagnon », et je
n’aurais jamais eu pour moi ma Rachel, mon enfant près de moi. Une autre femme
voudra te donner un frère ou une sœur… (jusqu’à présent cette perspective je l’ai
repoussée mais un jour une femme sera enceinte de moi, c'est clair!).
C’est la vie ! Cependant, lorsqu’on sera un peu plus
vieux, que tu auras des enfants et qu’ils auront un grand-père quelque part,
peut-être qu’ils voudront le connaître et je t’attendrai tranquillement dans « mon
silence ». J’aurais fini une autre tranche de vie, peut-être aussi j’aurais
écris un livre ou deux, et qui sait si ce type d’enfants nés de mon esprit, ils
n’auront pas effacé de ma vie les yeux de mon passé et ceux de tous les miens. Je
ne sais pas pourquoi je dis ça. J’ai l’impression de vouloir fuir, de vouloir
quitter un passé pour m’en construire un autre plus près de moi. C’est drôle,
mais je constate qu’en venant ici, en Inde, chaque fois et depuis ma première visite,
je me sens comme chez moi. Tu partages mes fibres, ça aussi c’est sûr ; comme tu
es contenue dans mes pensées, dans mes histoires et dans mon cœur. Et celui de
mes amis qui me demandent de tes nouvelles sans poser trop de questions.
Rachel, ma fille, tu n’es pas seulement une image, celle
d’une partie de mon passé, celle des photos serrées dans la poche d’une veste, ou
des souvenirs de dimanche ou de jour de lune. Rachel, tu vois ma fille, c’est
un monde, un univers de souffles, de rires, de paroles et de parfums qui
traversent mes heures et mes rivières de bonheur. Comme un rêve de Saint-François,
qui parlait aux oiseaux et qui soignait les chats et les chiens crevant au bord
des villages. Rachel dans ma tête, sa voix a le timbre d’un ange traduisant les
signes du ciel, les nuages de mousse dans mon café noir que je bois au lever du
soleil. Elle avait le visage de l’autre sur l’autre rive, le sourire du passeur
sur le fleuve de la vie et je respirais son ivresse quand on était arrivé sur
la berge. Exalté sur un fond d’ocre jaune son regard est blanc transparent,
comme Rachel éternelle.
Je te laisse là. Je t’aime très gros. Ton père. »
J’avais découvert et lu cette lettre, en plein milieu d’un
roman où les êtres s’effondraient dans les derniers lambeaux d’humanité en
crise, tourmentés mais sublimement accrochés à la plus extrême sensualité, dans
un Japon décapité. Je sautais d’un univers à un autre en l’espace d’une mince
feuille de papier. La plupart de la pièce était dans l’ombre. Un étranger
parlait dans le couloir. Je ne bougeais pas. Mes doigts collaient aux pages à
cause de la chaleur et pourtant je n’arrêtais pas de prendre l’air du
ventilateur. « Ecrire à son enfant », chuchotais-je. Je pensais à ce
type qui avait laissé un morceau de sa vie à moitié déchiffrée. Ecrire à son
enfant c’est un peu comme si l’on s’écrivait à soi-même ! Pour se dire ce
qui au plus profond de nous génère la vie. Des mots qui nous font du bien. Et
les autres, sans le savoir. C’est retomber dans sa propre chair, visiter un
dialogue originel entre Dieu et soi. Parler à son enfant avec des yeux
d’amant... Il avait dû s’endormir en pleurant.
mercredi 5 décembre 2012
L’Oracle de Delft (extrait)
Vermeer, Vue de Delft
« Toi qui ne brûle pas du désir
de savoir et de l’amour de la liberté, évite cette pierre tombale ». Hugo de Groot.
Hormis
l’ambiance religieuse et quasi surnaturelle du lieu, qui concourt à remplir d’un
sentiment de grandeur toute âme en quête d’unité, mon cœur dû tressaillir
devant l’épitaphe inscrite sur une dalle de pierre dans le déambulatoire de cette
Nieuwe Kerk, sous le mausolée
d’un homme de justice. Elle dit ceci : « Toi qui ne brûle pas du désir
de savoir et de l’amour de la liberté, évite cette pierre tombale ».
C’est signé Hugo de Groot.
Je me sentais comme foudroyé et honteux. Pensant aux divers ethnocides et
génocides de notre histoire, aux droits de l’homme bafoués encore à notre
époque, à la destruction drastique d’un environnement fragile, à l’occultation cynique
des sagesses anciennes, je me demandais combien d’hommes s’étaient levés dans
le monde, depuis près de quatre siècles, qui purent fréquenter cet apostolat
sans culpabilité.
Un
être seul, dit-on, c’est une interrogation dans un texte. Un point qui séduit,
mais qui, en même temps, génère un certain malaise. Tandis que le train
rencontre la lumière fractale et que s’alternent les sirènes de la locomotive
et les annonces de l’hôtesse, silencieusement je m’isole. Je me retire du monde
pour errer dans le maquis des ombres. Bizarrement, c’est là que l’homme semble
puiser sa force psychique. Dans ces formes fantasques qu’il tente de réunir
maladroitement. Les mirages sont des écueils auxquels on se raccroche par temps
d’orage. Le contrôleur s’approche :
-
Goedendag ! dit-elle, avec un sourire de blonde courtoise dans sa tenue
bleu nuit largement éclaircie par son teint nordique.
-
Dag !
Retiré
du néant, je présente mon ticket, tout heureux et profitant de l’interlude pour
croiser deux ou trois regards distraits au hasard des passagers assis dans le
wagon. Depuis le départ, en fait, j’étais absorbé dans mes monochromes. Les
visions d’un passé encore chaud tournoyaient et je respirais, je crois, n’ayant
plus conscience des autres voyageurs. Mais ici tout est calme, ou presque...
-
Dank u ! « bon voyage », ajoute-t-elle en français.
Un
peu plus loin, deux enfants jouent avec un panier posé sur la table. Il est
ouvert. Un troisième, amusé, regarde. Puis un animal, un petit chat de
gouttière noir et blanc, il sort du panier et fait des bonds, des petits sauts
très précis. Il se jette vivement sur les objets que les mômes lancent au
milieu de la table, il les fait gicler en l’air et aussitôt regagne son abri.
Les gosses rient en boucle, en toute complicité. Ils sont satisfaits de cette
comédie animalesque. Et ils recommencent… le chat, les objets, le panier, les
rires. Déjà, mes membres sont revivifiés. Je me lève pour aller dans le couloir
fumer une cigarette. Juste histoire de faire autre chose. Le jeu des gamins m’a
un peu rafraîchi.
Ces
enfants, malicieux et frivoles, qui jouent en face du monde, et parfois des
pires dangers, je les vois génies, anges, lubies. Agrandis par tout l’amour qu’on
leur a donné, la générosité qui leur a fourni l’espace d’une vie sécure et
l’intérêt qu’on leur accorde à chaque instant, ils savent rendre la joie
visible au cœur des tourments de nos vies pétrifiées d’adultes. Les visages des
enfants, souvent radieux, opèrent dans mon âme, insensiblement et comme par
magie, une transfiguration qui souligne mes conceptions distordantes. « Le
royaume de Dieu appartient aux enfants », dit Jésus. L’impermanence
des choses est transcendée dans l’oubli de soi. L’oubli de soi, la sérénité,
n’est possible probablement que par l’abandon des expériences passées. Parce
que l’apport de ces expériences recouvre, falsifie et dénature
l’innocence ; parce que la mémoire tue l’instant naïf.
La
lumière coule à flots impétueux. Les contraires se croisent, et dans le prisme
des formes ils éclatent en rayons de couleurs transparentes. Puis, ils
s’effacent, ils renaissent, ils s’effacent et je me dégage de leur radiance.
Ils renaîtront. Mais, lentement, je retourne à mes souvenirs. Je remonte à ce
matin de juillet, pendant les vacances scolaires, pendant que les champs sont
tout blonds, où nous avions regardé des pierres. Nous les jetions dans un
étang, et à mesure qu’elles coulaient nous recommencions le cœur en liesse.
Dans les rares moments de calme, j’étais absorbé dans un spectre de lumière, un
miroir brisé qui laissait transparaître des traces anguleuses. Celles des
arbres autour, descendues du ciel pour se plaquer dans les eaux mortes, celles
des herbes fluides, fascinantes comme des fées, comme des drogues douces.
Avec
les visages fleuris d’enfants libres, nous étions plein de gaieté et de
désinvolture ; Claude, c’était un papillon, un sourire inscrit dans l’air
et qui se respirait comme un parfum d’oranges. Il semblait être nu comme un
têtard, une vierge dans l’absurdité du moment. Brahim, lui, donnait ses grands
yeux et toute son ardeur aux plaisirs du compagnonnage. La vie est une
succession d'événements, dont l’origine nous est incertaine. Dans cette eau,
calme et stable, aux puissants reflets d’or et d’argent, il y avait de la vie.
Au commencement surtout, elle était dans la vie et la vie même. Nous sommes
arrivés et tout a changé.
Les
décisions d’hier sont les moteurs ou les freins d’aujourd’hui, et qui que nous
soyons devenu, elles nous apprennent encore à décider pour demain. Quelque fois
on se dit que cela n’a pas d’importance et que tout ira mieux. C’est une des
raisons de la vie active et intense que nous choisissons. Les bulles qui
remontaient du fond nous faisaient rire, et l’étrangeté de l’acte ne nous
saisissait aucunement, nous passions outre. L’absurde se baladait discrètement
parmi les stridulations d’insectes, abondants, et les croassements confus des
corneilles excitées. Nous venions à cet endroit pour connaître la mort, la fin
d’une vie de chat.
Ce
chaton, au poil blanc immaculé, avait eu cette fin tragique — traqué par trois
jeunes loups inspirés de mauvais plans —, trahit par ses pépites azur — on
disait de cette espèce qu’elle était atteinte de cécité —, nous l’avions noyé
au fond du « marais des noces » ; c’était le nom qu’on donnait à
cet endroit, proche de la cité, où les couples venaient se baptiser dans la
sensualité des corps, épiés par les regards illimités de la nature. « Il
coule », assura Claude d’un ton naïf. Le commentaire fut bref. Alors que
nous observions la vie se transformer en bain d’eau glacé, nous prenions
conscience de notre médiocrité. Nos notes grotesques obtenues à l’école de la
complaisance, les actes ridicules d’une jeunesse traînante et sans esprit
rendaient notre présence d’un intérêt superfétatoire.
Nous
étions là sans y être vraiment, nus, fixés dans le décor. L’acte nous avait
submergés et la parole avait été engloutie au fond de la mare. A quelques
mètres seulement. Quelques minutes suffirent à mes deux frères pour coller à
leurs vêtements. Nous étions devenus membres d’une confrérie secrète.
Connaissants d’un savoir minable, mais somme toute initiatique, la peur d’être
pris pour des assassins nous fit apprendre à garder le silence. Nous prîmes le
chemin à rebours avec des visages de tombes et, en nous jurant de ne rien dire
à personne, avec un gros noeud dans le ventre. Le chat est mort, mais
qu’importe, toute transition fait changer de peau. En même temps qu’on délaissait
les « choses du passé », le présent, lui, nous réjouissait déjà d’une
prise de conscience au caractère profond : la vie était devenue un sacre.
La
symbolique des événements frappe notre conscience, dès lors qu’elle est
éveillée et, surtout en rapport avec l’ouverture de notre esprit, elle inspire.
La mort, la nature féline enfouie dans les profondeurs de l’inconscient — sorte
de réserve mystérieuse de forces et de pulsions —, la sexualité créatrice et
destructrice de l’homme, nous commencions à découvrir cela à cause du silence
qui régnait autour de la mare. Le temps était venu pour nous de comprendre ce
que signifiait la mort, comme disparition et comme silence indéterminable.
Parce que toutes les images de la mort se ramifiaient parmi tous mes souvenirs,
je réalisai subitement, avec cette sorte de lucidité, cette faculté
d’interprétation de ma propre vie, que finalement je n’étais qu’un passager.
Comme
dans ce train, alors le yin et le yang se dessinaient dans ma mémoire
rétinienne, dans cette mémoire d’adolescent qui balayait toute incertitude et
qui transformait le souffle en absence. L’orgueil, ce n’est pas une faute qu’on
a peur de corriger, ou une faiblesse qu’on veut entretenir par satisfaction ou
par plaisir, mais c’est une maladie de l’âme adolescente qui s’attache à sa
propre importance sans regard pour les autres. Comme la nature, cette mère si
sage qui nous avait regardés, nous avons dû de temps en temps quitter nos sales
vêtements usés en pleurant, même ceux qui nous faisaient paraître merveilleux,
pour recueillir le silence de la nudité et contempler notre petitesse en riant
aussi.
dimanche 30 janvier 2011
samedi 17 avril 2010
Inscription à :
Commentaires (Atom)